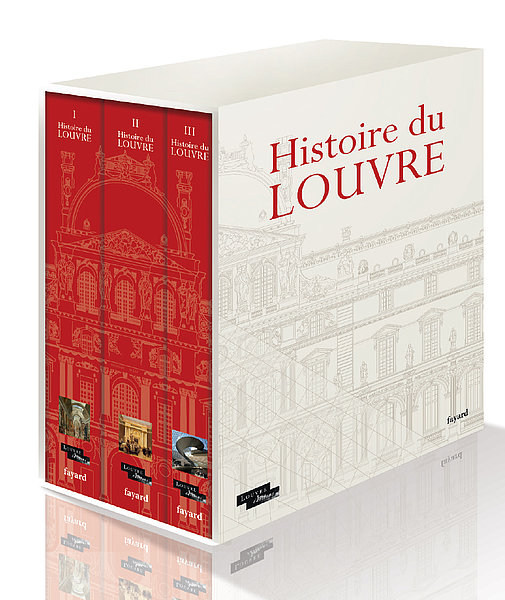Dominique Poulot
D’après les publicités de l’éditeur il s’agit d’un “monument”, et l’affirmation n’est pas mensongère à considérer le poids des volumes, le nombre des pages, près de 2000, et celui des auteurs, plus d’une centaine. Tout ceci est à rapporter à l’ambition de l’entreprise, celle d’offrir un tableau de l’histoire du Louvre tenue pour “un condensé de l’histoire de France et de celle des musées”, selon la formule du président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, qui ouvre l’ensemble. Il s’agit encore, pour lui, d’écrire “une histoire du Louvre pour aujourd’hui”. Dans ces conditions, en rendre compte, ne serait-ce que dans ses principaux aspects, exige de cavalcader à travers les départements et les œuvres, à l’image de la course à travers la Grande Galerie filmée par Jean-Luc Godard en 1964 dans Bande à Part.
Les deux premiers volumes offrent une synthèse historique nourrie des travaux les plus récents portés à la connaissance des conservateurs, comme de la tradition “maison” des études louvresques, si l’on peut dire, qui sont recensées de manière minutieuse, notamment pour les mémoires de l’École du Louvre, dans l’abondante bibliographie offerte au troisième volume. Ce dernier est un dictionnaire, mais qui se distingue tout à fait des nombreux “dictionnaires du Louvre” précédemment parus. On n’y trouve en effet ni le panthéon des artistes représentés dans le musée, ni le défilé des conservateurs ou des bienfaiteurs les plus illustres. À l’inverse, l’histoire économique, l’histoire institutionnelle, sociale et politique, syndicale même, ou l’histoire matérielle, dans ses aspects techniques, du mobilier d’exposition à la conservation-restauration, sont bien présentes. De ce point de vue, la leçon historiographique de l’exposition montée en 1994 par Chantal Georgel à Orsay, La jeunesse des musées, a été retenue. Qu’on se rassure toutefois, le dictionnaire a bien un article “Joconde” pour sacrifier à la tradition—un article qui remarque du reste que les conditions de sécurité imposées aujourd’hui au spectateur “empêchent malheureusement d’admirer le véritable mystère de cette peinture”.
Le premier volume déploie, en plus de 700 pages, l’histoire du Louvre, du “Louvre avant le Louvre”, c’est-à-dire, assez curieusement, depuis la préhistoire du lieu, jusqu’à la Révolution et l’Empire, en passant par les résultats des fouilles archéologiques menées dans les jardins du Carrousel entre 1989 et 1990. Toutefois, sa couverture, empruntée à la Vue imaginaire de la Grande Galerie de Hubert Robert, place clairement ces développements sous le signe du musée davantage que sous celui du palais. La couverture du deuxième volume est décorée quant à elle d’une vue du musée Napoléon III, correspondant à l’épisode de la collection Campana, qui renvoie à ce que Jean-Luc Martinez appelle “l’âge d’or de l’archéologie dans le musée”. Il faut souligner l’attention portée par les responsables du tome aux décennies 1840-1860—une attention qui s’inscrit dans le renouvellement actuel de l’histoire intellectuelle et culturelle du milieu du 19e siècle, et dans celui, spécifiquement, des études de musées notamment avec Arnaud Bertinet et son livre sur le Second Empire.[1]
Ce deuxième volet de l’entreprise illustre à cet égard une forme de continuité des interventions du pouvoir, autrement dit du fait du Prince au Louvre. Le legs de Napoléon III à l’architecture du lieu est en effet considérable, et celui de François Mitterrand, in fine, ne l’est pas moins. Si la construction du livre suit étroitement la succession des régimes politiques, de la Restauration à la cinquième République, deux épisodes bénéficient d’un traitement spécifique : il s’agit des réformes de Jeanron d’une part, de 1848 à 1851, et de la réalisation du Grand Louvre, de 1981 à 1998, d’autre part. Au passage, beaucoup de lecteurs apprendront que le plan d’Henri Verne pendant l’entre-deux-guerres, conçu à un moment généralement jugé sans grand éclat pour l’histoire des musées de France, et marqué par la crise économique, a été en réalité un moment-clé de l’histoire du musée, même après 1945, et qu’il a influencé l’organisation ultérieure du Grand Louvre. L’histoire du musée paraît de la sorte rythmée par une succession d’hommes sinon providentiels au moins visionnaires, capables de formuler à un moment des vues d’ensemble de développement qui ne triomphent peut-être pas immédiatement mais seront reprises par la suite, le tout sur un fond d'”histoire stratifiée et incohérente”, selon une formule de Jean-Luc Martinez. Peut-être est-ce aussi une figure rhétorique des études louvresques qu’il faudrait déconstruire.
Accusera-t-on cette histoire de céder au présentisme, en sacrifiant trop aux dernières décennies ? Eu égard aux transformations considérables du tournant des 20e et 21e siècles ce serait lui faire un mauvais procès. D’autres reproches sont en revanche possibles, d’ailleurs évoqués clairement par les auteurs eux-mêmes. Le péril de la téléologie n’est pas loin, en effet, dans la perspective d’une histoire du lieu qui commence, encore une fois, avant le Louvre lui-même, comme si ce coin de la terre eût été prédestiné à accueillir quelque réunion de chefs-d’œuvre. L’autre danger serait d’écrire une histoire officielle, surtout pour l’histoire immédiate de l’établissement, qui pourrait tourner à la compilation de communiqués de presse et de témoignages d’approbation.
En fait, le récit entend plutôt mettre en évidence de grands moments, des nœuds historiques qui correspondent souvent à de nouveaux départs, à des reprises de desseins antérieurs, voire de projets jugés plus ou moins utopiques dans leurs premiers moments. Il montre surtout, peut-être, que derrière “l’histoire du Louvre” bien des histoires se croisent, ou se superposent, et aussi bien des fantômes : ceux des musées disparus, quand le Louvre du 19e siècle était un “musée de musées”, comme celui des Tuileries, détruites à la fin de la Commune et jamais reconstruites par la République, pour des raisons évidemment symboliques autant que pécuniaires ou opportunistes. La revendication d’une universalité du Louvre est bien présente dans l’histoire des musées successifs du 19e siècle, comme dans la présentation de l’entrée des “arts premiers”, ou celle de l’installation du département des arts de l’Islam. Le “grand récit”, à cet égard, est celui du passage des conquêtes archéologiques à des formes de collaboration et d’échange scientifique qui ne contribuent plus directement à enrichir les collections du musée. En somme, l’universalité de l’expertise viendrait idéalement remplacer l’universalité du collectionnisme, avec d’autres enjeux.
Pour naviguer dans les soixante-cinq entrées du Dictionnaire proposé au dernier volume, les auteurs suggèrent trois chemins de lecture, qui peuvent valoir au demeurant pour l’entreprise tout entière. On y trouve d’abord en effet une lecture de l’histoire des collections du musée, qui s’attache aux départements, et à leurs documentations. On y découvre ensuite un panorama de la “ville Louvre”, pour reprendre le titre du film de Nicolas Philibert sorti en 1990, avec ses métiers, son administration, ses publics. Enfin on y mesure le rayonnement du Louvre, dans sa politique scientifique, mais aussi ses antennes, nationale et internationales. On lit évidemment avec curiosité les entrées “Louvre Abu Dhabi” et “Louvre Lens”, très politiques, la première protestant d’un universalisme qui serait capable de renvoyer “dos à dos uniformité et communautarisme”, et la seconde affirmant la vocation d’un lieu de partage qui vaudrait “désacralisation de l’institution muséale”. Par là, ce dernier volume vient compléter l’histoire chronologique de l’établissement d’un répertoire de notions plus ou moins liées à la muséographie et à la muséologie, pour reprendre une distinction classique.
Dans la mesure où, à bien des égards, il s’agit d’une prosopopée du Louvre, l’ouvrage témoigne de ses origines : une commande portée par trois présidents-directeurs successifs, qui avaient chacun imaginé des enjeux particuliers à l’entreprise. Geneviève Bresc-Bautier expose clairement les vicissitudes de ces projets, dont le format et le découpage ont varié, entre la seule histoire du musée, à partir des programmes des Lumières, puis une histoire du palais et du musée divisée en deux tomes, pour finir avec le dessein actuel. Le propos a fini par mêler l’archéologie d’un site, l’histoire de bâtiments illustres, l’histoire de la politique française, enfin celle des musées de France, tout en répondant à un aggiornamento de la littérature du Louvre sur le Louvre.
On aurait pu imaginer quelques éclairages étrangers, et une comparaison, ne fût-ce qu’à l’échelle européenne, avec d’autres établissements voisins par la taille ou l’ambition—serait-ce que l’équipe éditoriale a jugé, précisément, le Louvre incomparable ? La mobilisation d’auteurs représentant des disciplines ou des intérêts divers, même s’ils font quasiment tous partie de la “ville Louvre”, est au moins le signe qu’il s’agissait de rendre compte de tous les aspects du fonctionnement d’un musée. Les sciences dites “dures” ne sont d’ailleurs pas oubliées, ainsi dans les développements consacrés à la place de la restauration au musée. Par contraste, et cela peut sembler paradoxal, les aspects proprement symboliques du Louvre semblent moins bien traités, mais il est vrai qu’on peut revenir, comme le suggère l’avant-propos qui dresse une sorte de fortune critique du bâtiment et du musée, à l’article “Louvre” de Jean-Pierre Babelon dans les Lieux de mémoire de Pierre Nora. La conclusion générale pose au moins la question du mythe du Louvre, et de ses actuelles incarnations ou contestations.
Un leitmotiv des études sur les musées installés dans des monuments historiques est de déplorer le caractère incommode des lieux, et le Louvre n’échappe pas à la règle tout au long de son histoire. Un inspecteur estimateur du Louvre, à la fois marchand et restaurateur, un de ces hommes-orchestres des musées du 19e siècle qu’a étudiés Christine Godfroy-Gallardo[2], Féréol de Bonnemaison, regrettait en 1818 “l’impossibilité où se trouvent les personnes employées à la restauration des tableaux de travailler dans la demi-salle qui leur est accordée, attendu qu’elles sont toute la journée dans un nuage de poussière, ce qui est très malsain et fort incommode pour la restauration”. Mais être logé dans un palais n’a pas que des inconvénients, et le musée en a tiré bien des avantages. Au point que dans la négociation, et parfois le combat entre le musée et le palais, le musée l’a définitivement emporté aujourd’hui. Jean-Luc Martinez souligne ainsi la très faible présence des traces du palais, et la difficulté à faire percevoir l’héritage de la vie de cour disparue aux visiteurs. Rendre visible l’architecture palatiale du Louvre demeure un enjeu d’aménagement à reprendre.
L’une des singularités de cette histoire du Louvre est assurément le poids du Prince, ou de l’État. Il est peu de nations—aucune ?—où la définition du “musée national” réponde à une centralisation semblable. Le Louvre est-il, du reste, un “musée national” au sens où d’autres pays—en Europe du Nord, en Europe centrale, ou orientale—emploient le terme pour singulariser tel ou tel établissement ? Sans être directement posée, la question parcourt les allusions régulières faites ici ou là à son universalité. Quoi qu’il en soit de cette question essentielle par ailleurs, on constate combien, de l’arrêté Chaptal de 1801 aux “envois” d’œuvres du milieu de la décennie 1870, puis aux dépôts de l’entre-deux-guerres, enfin à ceux de l’immédiat après-guerre, la vie du Louvre a été déterminante pour celle de bien des musées de régions. Bien entendu, la responsabilité de la société civile a été à certains moments non moins capitale, en raison de l’importance de certains legs et de leur capacité à renouveler l’imaginaire des modèles offerts aux artistes.
L’autre fait remarquable de cette longue histoire est l’ampleur du succès, particulièrement aux dates récentes, de l’institution. Quand, comme le relève son président-directeur, le nombre des visiteurs passe de quatre ou cinq millions à plus de neuf en vingt ans, les prévisions architecturales et muséographiques font faillite—et le bâtiment lui-même est menacé. Comment comprendre de pareilles mutations, et leur rapidité ? Il est clair qu’ici le cadre monographique ne suffit pas. Comme le rappelait Pierre Bourdieu à la génération précédente, dans le colloque commémoratif consacré au musée des Offices en 1982[3], pour expliquer ce qui se passe au musée il faut en sortir, et en l’occurrence mobiliser les ressources réunies par les services d’enquête et de recherche du Ministère de la Culture, les analyses sociologiques et historiques des changements éducatifs et culturels, bref toute une bibliothèque dont Anne Krebs rend compte par exemple dans un article[4].
Une autre singularité de l’entreprise, comme de toutes celles qui touchent à l’histoire immédiate, est son rapport à la mémoire vivante des acteurs de tel ou tel épisode, confrontés à une vue censée être plus générale, plus synthétique, mieux justifiée en tout cas de ce qu’ils ont vécu et de ce qu’ils ont pensé sur le moment. À titre personnel, ayant assisté à nombre des premières manifestations de l’auditorium du Grand Louvre—comme beaucoup d’historiens de l’art français—je suis étonné de lire dans un article la reprise de vieilles rengaines d’époque à propos des délires—un Woodstock de l’histoire de l’art—auxquels la décennie 1980-1990 aurait donné lieu. Au contraire, la programmation de l’Auditorium, neuve et parfois iconoclaste, a joué alors un rôle majeur dans l’ouverture du public parisien, spécialisé ou non, à l’histoire de l’art internationale, anglo-américaine en particulier, mais pas seulement. Avant l’ouverture de l’Institut national d’histoire de l’art, au carré Vivienne, qui a fourni des locaux et des équipes chargées de les animer, et dans une période de stagnation de l’histoire de l’art universitaire en France, le Louvre a été une fenêtre ouverte, un forum peut-être, mais aussi un espace de recherche fécond. Il a joué le rôle qu’avait eu Beaubourg en son temps, notamment autour du Centre de Création industrielle, de sa revue et de ses éditions, et qu’aura par la suite le Musée du Quai Branly à son ouverture, autour des enjeux de l’anthropologie pour l’histoire de l’art.
En d’autres termes, l’histoire récente du Louvre s’est inscrite—et comment aurait-il pu en être autrement ?—dans la série de bouleversements de la vie culturelle et des métiers intellectuels que la France a connue, et elle en a rendu compte assez exactement. Le Louvre a en effet joué un rôle non négligeable dans ce qu’on peut nommer la médiatisation de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et plus largement dans un devenir spectaculaire de certains champs de savoir académique. Les invitations prestigieuses initiées par le département des arts graphiques à l’égard de tel ou tel intellectuel, puis les chaires du Louvre, ont permis une visibilité inédite à certains travaux ou à certaines réflexions internationales, sans parler de l’ouverture aux média audiovisuels et au spectacle vivant. Il y a désormais des vedettes, voire des stars du et au Louvre, qui appellent un nouvel Edgar Morin pour les analyser utilement.[5]
Le livre pose à plusieurs reprises une question qui n’est évoquée explicitement qu’à une occasion, à savoir celle du principe du musée, pris entre “deux projets : fournir un support à l’imaginaire et à la création par des artistes contemporains ou œuvrer à la connaissance des œuvres qu’il conserve”. Le Louvre, au cours des dernières décennies, a connu de fait plusieurs modalités d’ouverture à l’art contemporain—autant d’expériences qui ont suscité moult débats, et quelques polémiques célèbres, et dont Ariane Lemieux a rendu compte.[6] Pareilles manifestations fournissent l’opportunité de poser une question plus vaste, celle de l’affirmation des hiérarchies et des légitimités au musée, rendue plus difficile ou au moins plus subtile à une époque “liquide”, globalisée, où les impératifs se mêlent, de manière plus ou moins contradictoire.
On pouvait attendre dans cette encyclopédie du Louvre une réflexion sur le nom même du palais et du musée. C’est peut-être là, comme le remarquait Paul Veyne, une demande propre au “nominalisme bien tempéré” de l’historien, et qui n’est pas le souci des professionnels de musées. Mais on doit bien noter, à tout le moins, que cette histoire, surtout dans ses développements récents, bien sûr, est aussi une succession de noms, dont le “Grand Louvre” a été l’avant-dernier, éclipsé depuis par l’usage du mot “Louvre” accolé à d’autres lieux et à d’autres établissements. La marque “Louvre” est telle aujourd’hui qu’elle impose une responsabilité considérable à ses promoteurs, sinon à ses propriétaires publics, et la présente histoire vient, semble-t-il, la conforter par son volume et par sa respiration de longue durée. Non qu’il s’agisse d’une opération de communication, et a fortiori de marketing, mais dans ce contexte si particulier du déploiement des grands musées “universels” il est intéressant de comparer l’entreprise à ses versions étrangères, dont L’histoire mondiale en cent objets promue par le British Museum au temps de Neil MacGregor, une opération sur des plate-formes multiples qui mobilisait la BBC à la fois en radio, en télévision, et sur internet, d’une manière particulièrement ambitieuse et originale [7]. Voilà assurément deux manières de dresser des monuments à des collections nationales qui en disent long sur les spécificités des musées nationaux à l’âge de leurs revendications mondiales.
Dominique Poulot is Professor of Art History at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne
[1] Arnaud Bertinet, Les Musées de Napoléon III. Une institution pour les arts (1849-1872) (Paris: Mare & Martin, 2015).
[2] Christine Godfroy-Gallardo, Les marchands de tableaux, experts des premiers musées nationaux en France et en Angleterre. Des appréciateurs aux compétences de conservateurs, thèse de doctorat soutenue le 29-11-2014 sous la direction de Dominique Poulot à Paris 1, dans le cadre de École doctorale Histoire de l’art (Paris), 2014.
[3] Gli Uffizi : quattro secoli di una galleria : Atti del Convegno internazionale di studi : Firenze, 20-24 settembre 1982, sous la direction de Paola Barocchi et Giovanna Ragionieri (Florence : Olschki, 1983), 2 volumes.
[4] Anne Krebs, “La connaissance des publics et de leurs pratiques”, Histoire du Louvre, tome III, 251-253.
[5] Edgar Morin, Les stars (Paris: Seuil, 1957).
[6] Ariane Lemieux, “Les collections permanentes du Louvre et l’exposition de l’art contemporain”, CeROArt. Conservation, exposition, Restauration d’Objets d’Art 9, CeROArt asbl, (2014), https://ceroart.revues.org/3794 ; et Ariane Lemieux, “Les artistes contemporains au musée du Louvre: méthodes de transmission du processus créatif en regard des collections”, Muséologies: Les cahiers d’études supérieures 8:1 (2015), 173-188.
[7] Neil MacGregor, A History of the World in 100 Objects (London : Penguin, 2011). Voir sur le projet Elizabeth Lambourn, “A History of the World in 100 Objects”, Journal of Global History 6:3 (2011), 529-533.
Cite this article as: Dominique Poulot, “Coda: L’Histoire du Louvre en perspective,” Journal18, Issue 2 Louvre Local (Fall 2016), https://www.journal18.org/1037. DOI: 10.30610/2.2016.8
Licence: CC BY-NC
Journal18 is published under a Creative Commons CC BY-NC International 4.0 license. Use of any content published in Journal18 must be for non-commercial purposes and appropriate credit must be given to the author of the content. Details for appropriate citation appear above.